N’arrêtez pas de voir la vie comme une aventure
-Eleanor Roosevelt
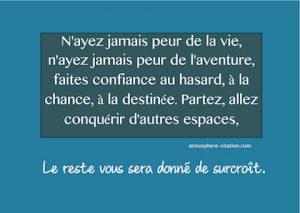
N’ayez jamais peur de l’aventures faites confiance au hasard, à la chance, à la destinée. Partez, allez conquérir d’autres espaces,
Le reste vous sera donné de surcroît.

N’ayez jamais peur de la vie, n’ayez jamais peur de l’aventure, faites confiance au hasard, à la chance, à la destinée. Partez, allez conquérir d’autres espaces, d’autres espérances. Le reste vous sera donné de surcroît.
-Henry Monfreid
…..
« Je suis décidé à tout perdre plutôt que de donner aux douaniers la satisfaction de m’avoir. » En 1913, sur les bords étincelants de la mer Rouge, Henry de Monfreid s’est fait trafiquant d’armes. Avec son boutre de planches à la grande voile arabe triangulaire, il doit livrer à des Abyssins dix caisses de fusils Gras qu’il a arrimées dans la cale. A Djibouti, les autorités coloniales craignent qu’on arme des rebelles : il est pris en chasse par le bateau des douanes, le daoueri, un voilier à la grosse coque blanche, plus long et plus véloce. Il s’échappe à la faveur de la nuit, saute les récifs grâce à la marée et mouille devant Maskali, l’île de sable rase où il a sa maison. Mais au matin, il aperçoit le mât du daoueri qui pointe derrière une dune comme une aiguille menaçante. Il se jette à bord et appareille. Nouvelle poursuite vent arrière sur les vagues bleues frangées d’écume du golfe de Tadjourah. Le long de la côte Nord coupée de falaises noires et de criques aux eaux cristallines, il voit dans son sillage la voile du daoueri grossir de mille en mille. La douane gagne sur lui, inexorablement. Dans une demi-heure, il sera pris. Mais derrière un cap qui le cache à ses poursuivants, au milieu d’une baie lumineuse, un autre voilier est à l’ancre. C’est un zaroug, le boutre rapide des contrebandiers qui ramassent le bois à brûler sur une côte pour le revendre sur l’autre. En une minute, Monfreid a son plan. Il pique sur le zaroug et lui crie que la douane arrive. Les voleurs de bois appareillent sans demander leur reste. Alors Monfreid démâte et saborde son bateau près du rivage. Un trou dans la coque : le boutre s’enfonce dans l’eau turquoise. Quand le daoueri double le cap, il voit une baie vide et une voile blanche qui cingle à l’horizon. Les douaniers la prennent pour celle de Monfreid. Ils se lancent à sa poursuite : sauvé !
C’est une fausse joie. Comme le vent forcit, la voile du daoueri se déchire. Il revient dans la baie pour réparer. Nouvelle frayeur : en s’approchant de la plage, les douaniers, voyant l’épave du boutre, vont éventer la ruse. Monfreid débarque avec son équipage. Il a distribué des fusils que les marins indigènes tiennent à bout de bras en marchant dans l’eau. Quelques espars du boutre émergent encore. Le daoueri vient sur eux. Monfreid et ses hommes sont cachés dans les broussailles. Ils tirent une salve en ayant soin de manquer leur cible. Peu soucieux de jouer les héros, les fonctionnaires se couchent sur le pont. Nouvelle salve. Les douaniers virent de bord et envoient un foc qui les tire vers le large. Le daoueri pusillanime s’éloigne, laissant le trafiquant rusé à ses affaires. Avec des sacs de riz qui gonflent dans l’eau, Monfreid occulte la voie d’eau. Il écope avec un seau et renfloue son bateau. La nuit suivante, il peut livrer ses fusils et toucher le prix de son odyssée.
Quinze ans plus tard, Monfreid publie chez Grasset le récit de cette aventure et de bien d’autres, qui forment les chapitres tumultueux de ces mémoires d’un frère de la côte somalienne. Les Secrets de la mer Rouge est un best-seller, suivi au fil des années par vingt romans de la même veine, qui sont autant de classiques des années 30. Fils d’un aristocrate riche et bohème, Henry de Monfreid avait commencé médiocrement dans la France de la Belle Epoque. Fantasque et rêveur, amoureux de la mer qu’il a fréquentée tôt sur le yacht familial, il manque ses études d’ingénieur et doit s’employer pour vivre. Il est colporteur, chauffeur de maître, contrôleur de lait chez Maggi. Il se lance dans l’élevage de poulets : les volatiles meurent en quelques semaines. Il monte une laiterie : les inondations de 1910 isolent les installations, il fait faillite.
Frustré, désargenté, il ne voit de salut que dans le grand large. Il s’embauche dans une société de négoce du café basée… en Ethiopie. La vie coloniale lui convient mieux, dans cette société à la fois hiérarchique et affranchie des conventions. Il commande ses boys, négocie avec les chefs de tribu, fume de l’opium, se fait éventer avec un panka et prend une femme indigène, mi-épouse mi-esclave, en petit nabab blanc révéré par des Africains soumis. Au bout de six mois, le négoce l’ennuie. Il part à Djibouti pour se rapprocher de l’océan. Là, c’est la révélation. Aux portes de la mer Rouge, il sent le grand vent de l’aventure qui souffle du Nord. Il achète un petit boutre, le Fath-el-Rahman, avec lequel il écume les côtes désertes ou hostiles de l’Erythrée et du Yémen, mouillant dans les criques isolées, louvoyant parmi les récifs de corail, étalant les coups de vent de sable, explorant les îles désertes brûlantes de soleil sur la mer bleu azur. Il tente la pêche aux perles, mais les perles sont rares. Alors, fort de son expérience maritime, il se fait contrebandier. A la tête d’un équipage indigène, il achète et vend des armes, du haschisch ou de la cocaïne. Il se mélange à une faune de colons avides, de fonctionnaires désabusés, de chefs de tribu retors, de pêcheurs faméliques et de marchands d’esclaves. Il en ramène une inépuisable provision d’histoires qui seront comme son capital africain. Tirés de sa vie en mer Rouge, les romans qu’il écrit à partir de 1931 sont vifs, pittoresques, menés comme un voilier ardent qui chevauche les lames. On y trouve le vent du large, les embruns d’une mer inconstante, le sens de l’honneur, un certain humanisme teinté de tolérance, un regard aigu sur l’ordre colonial que Monfreid ne conteste pas mais dont il réprouve les abus. On y trouve aussi les préjugés de l’époque, un racisme tranquille, la foi dans la supériorité naturelle de l’homme blanc et le cynisme du trafiquant qui gruge ses clients ou qui vend des armes aux esclavagistes. Il a plus d’amis chez les indigènes que chez les Blancs, il se convertit à l’islam et adopte le mode de vie à la fois licencieux et frugal d’un cheikh au profil d’aigle et aux affidés obséquieux.
A la fin des années 30, Monfreid, l’anarchiste réactionnaire, prend fait et cause pour l’Italie qui envahit l’Ethiopie. Il admire Mussolini, en qui il apprécie l’énergie, le romanesque et son dédain des démocraties terre à terre. Juché sur sa réputation d’expert de la Corne de l’Afrique, il se fait propagandiste du fascisme, tient des conférences en faveur du Duce, envoie aux journaux de Paris des grands reportages où il loue l’oeuvre coloniale des Italiens et oublie de parler des gaz de combat que l’armée italienne utilise contre les soldats du Négus armés de pétoires. Au milieu de la guerre, les Italiens font retraite devant les troupes anglaises et les Français libres. Monfreid est arrêté et jeté en prison pour intelligence avec l’ennemi. Libéré, il se retire au Kenya puis en France, où ses errements politiques sont peu à peu oubliés. Ainsi il a louvoyé entre les écueils de l’histoire, passant de la littérature d’aventure, libre et sauvage, à la servilité envers un dictateur un peu bouffon, comme il louvoyait sur son boutre entre les récifs meurtriers et les horizons rêveurs.
Le malheur n’use et ne ravage
Que ceux qui s’arment contre lui
Sachons en supporter l’outrage
Pour mieux combattre l’ennui.
-Henry Monfreid (Hymne a la mer 2012)
…..
On hait dans la proportion où l’on peut aimer ; ce sont les deux pôles entre lesquels combattent, s’exaltent ou se détruisent nos facultés affectives
-Henry Monfreid (Aventures en mer rouge 1989)
…..
L’argent peut procurer n’importe quoi, c’est une force aveugle ; aussi n’avons-nous pas, pour ce qu’il procure, cet amour et ce respect que seul nous donne le fruit direct de notre effort.
-Henry Monfreid (Aventures en mer rouge 1989)
 Fais de chaque jour un tremplin pour remplir ta vie d’aventure, de passion et d’
Fais de chaque jour un tremplin pour remplir ta vie d’aventure, de passion et d’